Journal de Courts Métrages Expérimentaux no 1
 |
| Images provenants de Intervals (2023) |
|
Films visionnés à la cinémathèque le 15 mai
2024, dans la série Film Talks 2 Voici de courts avis sur sept des onze courts
métrages expérimentaux projetés à la cinémathèque dans le cadre de la deuxième
partie de Film Talks. Leaving and Arriving par Lynn Loo (2017) Ce
film montre le départ et l’arrivée d’un train à la gare filmé depuis
l’intérieur d’un wagon. L’arrivée et le départ partagent le même écran en deux
parties. Pour la plupart, ils sont simultanément à l’écran, mais il arrive
également que le départ soit montré indépendamment de l’arrivée et l’inverse
est également vrai. Dans ces cas, l’autre moitié de l’écran est laissé vide.
L’originalité de ce film consiste à superposer une partie de la vidéo montrant
l’arrivée et une partie de la vidéo montrant le départ au centre. Cela donne
l’impression que le train est bête à deux têtes partant dans des directions
opposées. Cela crée un décor pour le moins intéressant alors que deux paysages
vus par les fenêtres sont à la fois très semblables et très différents. On
peut voir ce film comme une réponse tardive au film des frères Lumières
intitulé L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat. C’est fascinant de
voir le progrès que l’on a fait et un évènement aussi simple peut encore être à
la source d’expérimentation en l’an 2020.
Available Light par William Raban (2016) Ce
film montre la lecture du Capital de Karl Marx en accéléré. Le
réalisateur a choisi de tourner seulement en utilisant la lumière naturelle
hivernale. Un choix excentrique qui présente une certaine complexité parce que
cela rend la lecture des pages plus longue. Mais, ce choix reste vain, car le
film joue en accéléré et que tout sentiment de difficulté ou de longueur
s’évapore. La lecture d’une page mal éclairée et celle d’une page éclairée
semble égale. D’ailleurs, il me semble un peu prétentieux de choisir de filmer
la lecture du Capital si la difficulté du sujet du livre n’a pas plus
d’impact sur le film. Par exemple, on aurait aimé voir le lecteur faire des
retours en arrière à d’autres pages, faire des annotations, surligner des
passages. Rien de tout ça n’arrive dans le film et c’est selon moi un potentiel
manqué. Pour ces raisons, le film ne semble pas présenter un grand intérêt.
Strontium
par Malcolm Le Grice (2021) Avec
ce film, le réalisateur a pris le parti de superposer à des images de voyages
d’autres images moins reconnaissables en ne gardant sur ces dernières que des
teintes de bleu et d’orange. Le résultat de cette expérience confère au film
une certaine force, il en ressort une anxiété apocalyptique peut-être même
nostalgique à voir les premières images si douces être recouvertes et
obscurcies par ces teintes de couleurs. Le sentiment d’anxiété ne peut être
qu’exacerbé par la bande-son. Produite avec les bruits fracassants d’une chute
d’eau sur des rochers, elle sait être à la fois doucement nostalgique et
terrifiante lorsqu’elle évoque les retombées radioactives d’une explosion
atomique. Cette dernière interprétation semble être confirmée par le titre de
l’œuvre. Intervals
par Simon Payne (2023) Des
bandes de couleurs primaires à opacité variables se croisent à différents
angles pour former des formes, des motifs, des apparences de mouvement. Ce film
est envoutant. Il semble impossible de distinguer la fin d’un mouvement fini et
le début d’un autre, car chaque image se dissout dans la précédente. Ainsi les
mouvements des bandes couleur se fondent l’un dans l’autre au lieu de se
terminer. Il est facile en regardant ce film de penser aux films de Norman
McLaren, par exemple, Lignes horizontales et Lignes verticales.
Si maintenant, faire ce type de film peut avoir l’air aisé, voire programmable
par ordinateur, il n’en demeure pas moins qu’une fois de plus il est prouvé
qu’on peut soutenir l’attention d’un public simplement en jouant avec les
couleurs, et les tempos. A State of Grace par John Smith (2019) Grâce
à sa narration et à son montage, ce film parvient à construire une histoire
toute simple à partir d’images que nous avons tous vues du moment que nous
avons lu les consignes de sécurités dans un avion. En interprétant, ces images
différemment, en les juxtaposant dans un ordre judicieux, le metteur en scène
parvient à faire rire et réfléchir sur l’anxiété. Les instructions de sécurité
d’un avion, nous les avons lues, et nous les avons entendues de la bouche du
pilote. Elles nous sont familières, mais pas pour le narrateur qui prend
l’avion pour la première fois. Avec ce film, le metteur en scène arrive à
démontrer l’importance du montage et la narration au cinéma. Au passage, il
prouve également que le cinéma expérimental peut faire rire.
Animal Studies par Guy Sherwin (1998-2023) Comme
l’indique le titre, cette série de films porte sur les animaux. Ceux-ci
tiennent le rôle principal par le fait qu’aucun scénario ou indication
biologique ou taxonomique n’est donné à leurs sujets. La caméra se contente de
filmer leurs mouvements aléatoires et la matière du film se trouve là. Elle est
ensuite quelque peu modifiée. Certains oiseaux semblent danser avec leur ombre.
Les lucioles semblent tracer des lignes de lumière sur un arrière-plan étoilé.
Les araignées semblent accomplir un rituel. Bref, avec les animaux le cinéaste
crée de la poésie. Les films deviennent ainsi bien plus que la simple étude
envisager par le titre. The
Oblique par Jayne Parker (2018)
Des
plans de magnolias sur une bande-son composée avec un violon. Les plans de
magnolias et ceux avec le violon sont en alternance les uns avec les autres.
Mais, même lorsque le violon n’est pas à l’écran, on continue à entendre sa
musique rendant les jolies fleurs de magnolia encore plus émouvantes. Difficile
de dire si les magnolias sont l’illustration de la musique jouée par le violon
ou si le violon est la voix des magnolias. Mais, dans tous les cas, autant de
beauté ne peut pas réellement laisser le spectateur indifférent. |

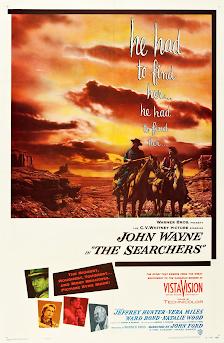

Commentaires
Publier un commentaire