Notes des Film Médiocres no 1
El
Topo (1970)
Il y a une grande
ironie à utiliser le western, surement le genre cinématographique le plus
américain, qui soit pour faire un film qui tire inspiration de toutes les
mythologies possibles sauf de la mythologie américaine. Jodorowsky montre donc
l’extension du Western plus que l’extension vers l’Ouest. Peut-être qu’on peut
apprécier le film de ce point vu. Par contre, on sera déçu de voir que le
mysticisme du film ne passe qu’à travers le prisme de la brutalité et que
toutes métaphores passent d’abord par l’envie qu’elles soient violentes avant
tout. Il y a une scène dans le film où El Topo après avoir secouru Mara de
bandits risiblement caricaturaux décide de la violer. Au-delà de la controverse
au tour de cette scène et des propos de Jodorowsky la concernant. Elle ne sert
à rien d’autre qu’à être là dans le film pour provoquer. Bien qu’elle ait un
effet sur la trajectoire psychologique du personnage féminin dans le sens ou
effectivement le personnage est moins réservé par la suite. Ces conséquences
paraissent accessoires, on sait bien que les viols n’ont pas ce type d’effets.
La scène a été inclue sans jamais qu’il y ait une réflexion sur les véritables
idées qui y étaient véhiculées. El Topo regorge de telles scènes qui cherchent
leurs significations après avoir été filmées pour provoquer.
(5/10)
Triomphe
de la volonté (1935)
Au regard de la
manière dont Triomphe de la volonté a été utilisé durant la Seconde
Guerre mondiale, il est impossible de distinguer la politique de l’art. Mais,
on n’a nullement besoin de ces considérations pour déterminer que le film est
nul. Le film dispose d’une certaine maitrise technique, mais il reste froid et
répétitif. Jamais Hitler ni ses idées ne paraissent réellement sympathiques.
Hitler sourit à un chat durant un défilé, mais ce sourire est tellement court
et relégué sur le coin de l’écran qu’il est facile de le manquer ou de le
mésinterpréter. Hitler reçoit un bouquet de fleurs d’un enfant durant ce même
défilé, on dirait qu’il lui arrache des mains et que sans le regarder il le
dépose à côté de lui. J’ai dit que ces deux évènements provenaient du même
défilé, mais ils pouvaient tout aussi bien provenir de deux défilés différents
puisque le film n’est qu’un enchainement de tels défilés (avec ici et là des
discours), il est facile de tout confondre. Le tout par la répétition finit par
être ennuyant et demeure peu convaincant. S’il y a une chose dont on doit se
soucier par rapport à ce film, c’est que jamais la pensée de Hitler et de
l’idéologie nazie n’est décrite de telles manières qu’elle semblerait
problématique à quelqu’un qui ne connaitrait pas les fondamentaux de la Seconde
Guerre mondiale.
(4/10)
Destination
Ultime (2000)
Pendant la durée
totale du film, on attend que celui-ci transcende un peu son postulat de départ.
Finalement, l’attente est vaine, car Destination Ultime n’a rien à dire.
Lire le synopsis pour voir comment les différents personnages mourront n’a pas
moins d’intérêt que de regarder le film. Les acteurs jouent mal, les dialogues
sont mal écrits. Les morts ont l’air tout droit sorties d’un mauvais Giallo et
encore je crois que comparer ce film à un mauvais Giallo est un trop grand
honneur. Le protagoniste est censé avoir des parents dans la première scène du film.
On ne les revoit plus après, on ne sait pas ce qui leur est arrivé.
(2/10)
Moonlight
(2016)
On aimerait
revenir dans le temps pour ne pas corriger l’erreur qui s’est produite aux
Oscars. Mais, trêve de plaisanteries. Il y a un bon film qui se cache derrière
Moonlight. Le film sait aller au-delà des préjugés qu’on pourrait avoir sur
certains classes sociales ou métiers tels que celui de revendeurs de drogues.
Ce n’est aucunement révolutionnaire, mais c’est un début. L’erreur de Barry
Jenkins c’est d’éviter les clichés en allant dans des représentations trop
positives et manquant de nuances. On arrive à un point où le personnage de
Mahershala Ali est si bon qu’il faudrait le renommer Saint-Juan de Miami.
L’empathie ne semble à créer pour le personnage qu’à travers des portraits
mélodramatiques de leurs enjeux. La mise en scène de Barry Jenkins cherchant
constamment la plus belle lumière pour éclairer la peau de ses personnages
n’aide pas. Cela dit, Moonlight ne manque pas de conflits et on peut lui donner
que tout rose bonbon et mélodramatique qu’ils soient, on s’intéresse aux
destins des personnages que Barry Jenkins écrit. (5/10)
Civil
War (2024)
Civil War pourrait
quand même avoir quelque chose d’intéressant à dire sur le journalisme ou la
politique sans prendre position. Il y
avait moyen d’être nuancé. Malheureusement, le film ne parvient pas à trouver
ce moyen. Il est assez clair que le méchant est le président lorsqu’on le
compare à Mussolini et aux autres dictateurs. Garland voulait éviter d’opposer
les républicains aux démocrates, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
d’antagoniste dans le film. Il en avait encore besoin parce que son film
s’adresse principalement au grand public qui veut un méchant. Ce méchant est le
fascisme puisque personne n’aime le fascisme. C’est donc une cible facile. Le
problème avec le film est qu’il n’a pas réalisé qu’il y avait un juste milieu
entre être apolitique et dénigrer l’un des deux principaux partis. S’il l’avait
réalisé, il aurait probablement dit quelque chose de plus intéressant. Regardez
le travail de Maroun Bagdadi. Il a réussi à créer une fiction sur une guerre
civile au milieu de la guerre civile qu’il décrivait. Ses films dénonçaient la
guerre sans même être une simple histoire bon/mauvais. Il parvient également à
mettre en lumière le travail du journalisme de guerre d’une manière qui semble
sincère et méditative. Les journalistes d’Alex Garland ne sont qu’une porte
d’entrée pour nous montrer les mêmes vieilles séquences de guerre.
(5/10)


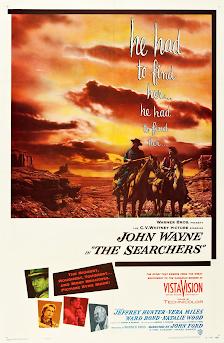

Commentaires
Publier un commentaire